Η έννοια του κακού στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Hegel
Ενότητα:
Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Χρονολογία έκδοσης περιοδικού
1977
Περισσότερα...
Τύπος
Επετηρίδα
Συγγραφέας
Μπαγιόνας, Αύγουστος
Περισσότερα...
Τίτλος άρθρου/ανακοίνωσης
Η έννοια του κακού στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Hegel
Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)
Θεματική ενότητα άρθρου/ανακοίνωσης
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Γλώσσα άρθρου
Ελληνικά - Νέα (1453-)
Γαλλικά
Περίληψη άρθρου
La philosophie de Hegel es une réflexion sur le conflit et la contradiction. Elle prolonge certains courants d’idées du dix-huitième siècle qui insistent sur les antagonismes sociaux et reconnaissent leur contribution au progrès de la civilisation. Ces courants sont représentés par les Physiocrates, B. Mandeville, A. Ferguson, A. Smith et d’autres. Le thème hegelien du conflit et de la contradiction est plus directement anticipé par Kant dans l’Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (quatrième proposition). Kant, toutefois, l’associe à la conscience individuelle, annonçant ainsi ce que Hegel appellera «l’esprit subjectif », dont l’histoire est décrite dans la Phénoménologie de l’esprit. Le caractère du conflit, de la contradiction et de l’antagonisme est un thème fondamental de l’idéologie bourgeoise au dix-huitième siècle. Les penseurs qui expriment les aspirations de la bourgeoisie française et anglaise intègrent ce thème à l’analyse de l’évolution sociale. Ceux qui, comme Kant et Hegel, traduisent les aspirations de la bourgeoisie prussienne, l’intègrent à une théorie du développement spirituel de formation la conscience de soi, dont l’évolution de la culture n’est qu’une manifestation. On pourrait expliquer cette différence par le fait que la bourgeoisie prussienne dépende matériellement et idéologiquement d’une hiérarchie sociopolitique de caractère féodal. Ainsi, la pensée allemande à la fin du dix-huitième siècle aspire uniquement à une illumination ou à une réforme spirituelle sans prolongements sociaux et politiques. Par contre la bourgeoisie française s’émancipe intellectuellement et moralement de l’ancien régime avec la philosophie des lumières et ses prolongements plus radicaux. Elle achève son émancipation avec la Révolution Française dont Hegel salue le principe et admet la nécessité, tout en déplorant son esprit d’abstraction et la terreur qui le concrétise. La Révolution, en tant que réalisation pratique de la philosophie française des lumières, montre que la bourgeoisie française ne se contente pas d’une illumination ou d’une réforme spirituelle. Le thème du conflit et de la contradiction est une de ses armes théoriques de guerre contre l’ancien régime. La bourgeoisie anglaise, n’ayant pas dû entrer en conflit violent avec l’ancien régime, associe le thème de l’antagonisme à une conception non révolutionnaire de l’évolution sociale. Hegel reconnaît le caractère contradictoire du réel. Ainsi, il admet dans sa Philosophie de l’histoire la réalité et la positivité du mal, expression du négatif au niveau de l’action et notamment de l’histoire universelle. Il rejette la conception leibnizienne du mal métaphysique qu’il considère comme «abstraite» et «indéterminée». Sans y faire explicitement allusion, il rejette également la conception leibnizienne du mal moral. Selon Leibniz le mal moral est un garantie de la possibilité du libre arbitre. Il implique donc une réhabilitation de l’individu, en tant que monade se suffisant à elle même. Selon Hegel le mal doit être interprété selon les catégories de l’ «histoire philosophique». Celles-ci nous montrent que les «individus» qui font l’histoire universelle sont les peoples et les nations. Les individus isolé et «abstraits» n’intéressent pas l’histoire philosophique. Elle ne se soucie ni de les réhabiliter ni de les consoler. Il en résulte que le mal moral est une catégorie inutile au point de vue historique. Le mal moral n’a de sens que dans le cadre d’une éthique «abstraite», «formelle» et «vide». Hegel confirme son refus du mal moral, implicite dans la Philosophie de l’histoire, en faisant l’apologie de la politique de Machiavel que nous lisons dans de nombreux textes, notamment la Constitution de l’Allemagne. La critique de Hegel concernant la conception du mal chez Leibniz doit être éclairée en fonction des appréciations de Hegel sur Leibniz que nous lisons dans son Cours sur l’histoire de la philosophie. Hegel reproche à Leibniz, notamment aux Essais de Théodicée, de tenter une conciliation avec les conceptions courantes du sens commun. A partir de la critique de Leibniz, Hegel montre que le mal doit être interprété par rapport à l’esprit, travaillant, luttant contre lui-même et niant les diverses formes de culture à lesquelles il s’exprime provisoirement et successivement.
Λέξεις -κλειδιά
Εγελιανή Φιλοσοφία
Γ. Φ. Χέγκελ
Κακό
Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA
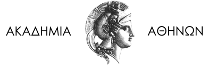




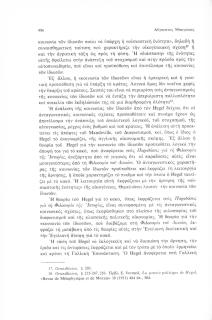


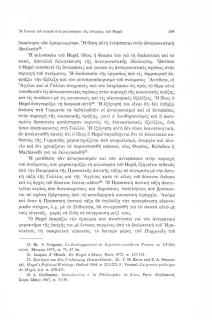

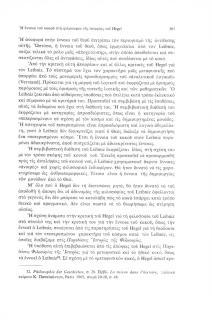
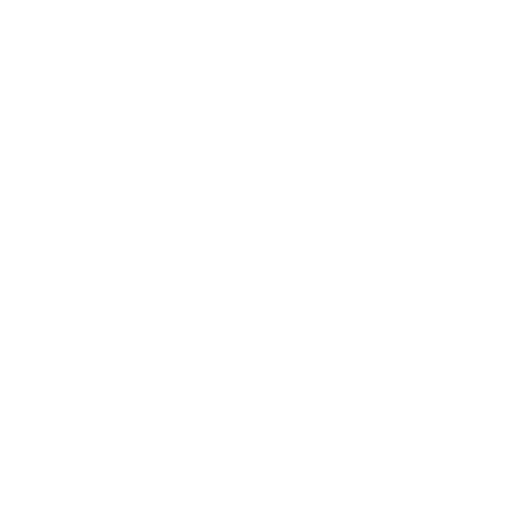 Ξεφύλλισμα pdf
Ξεφύλλισμα pdf